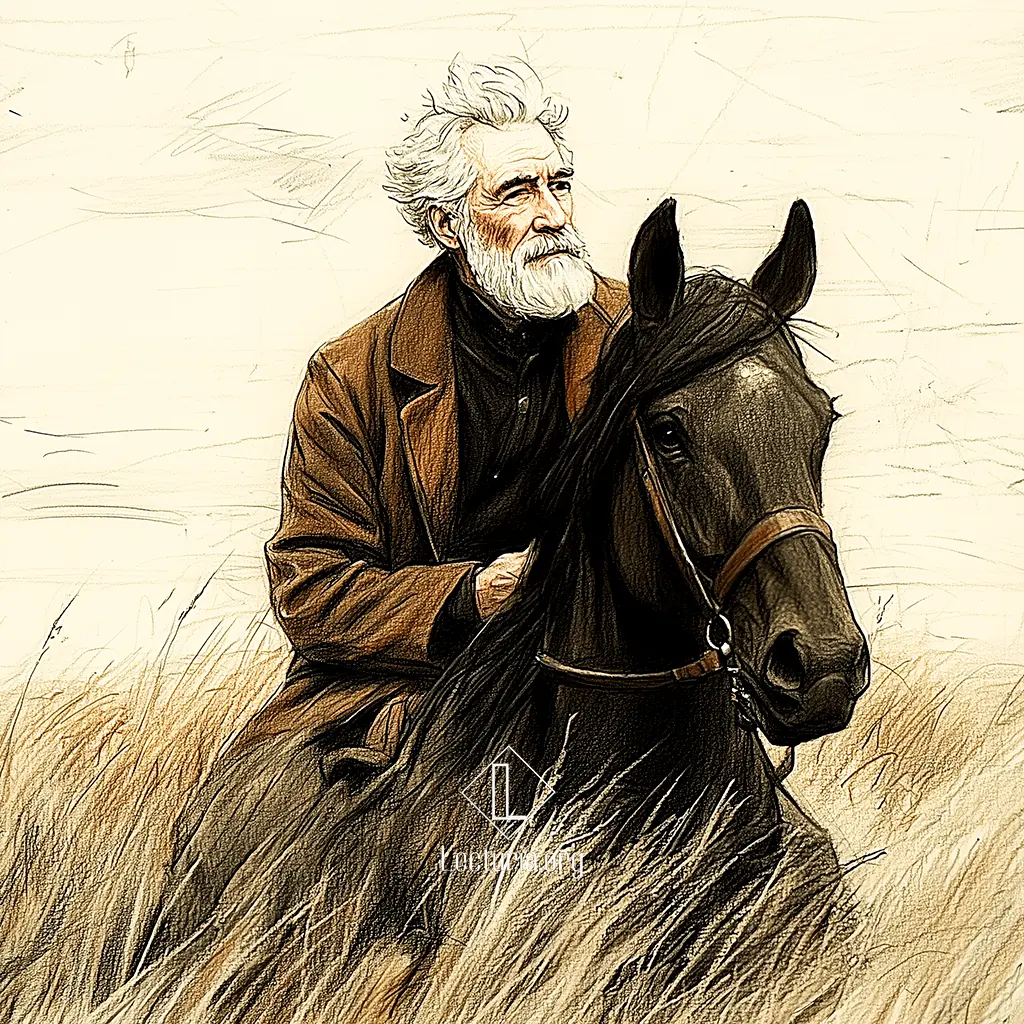Résumé de l’intrigue : « Le gaucho insupportable » (El gaucho insufrible) est une nouvelle de Roberto Bolaño publiée en 2003. Après être devenu veuf et avoir vu ses enfants partir, l’avocat Manuel Pereda mène une vie ordonnée à Buenos Aires jusqu’à ce que, lors de la crise économique du début du XXIᵉ siècle, il décide d’abandonner la ville pour se retirer dans l’ancienne estancia familiale, dans la pampa. Dans un environnement rural dégradé et envahi par les lapins, il tente de reconstruire sa vie, entouré de gauchos appauvris, d’enfants dénutris et de personnages excentriques. Peu à peu, il répare l’estancia, tisse des liens avec les habitants du lieu et entretient une correspondance avec ses anciennes domestiques. Il reçoit la visite de son fils, un écrivain à succès, ainsi que d’autres habitants de Buenos Aires, mais reste fidèle à sa retraite. Finalement, il retourne brièvement à la capitale pour signer la vente de son appartement. Après une altercation avec un écrivain dans un café et se sentant étranger dans une ville qu’il ne reconnaît plus, il décide de revenir à la pampa.
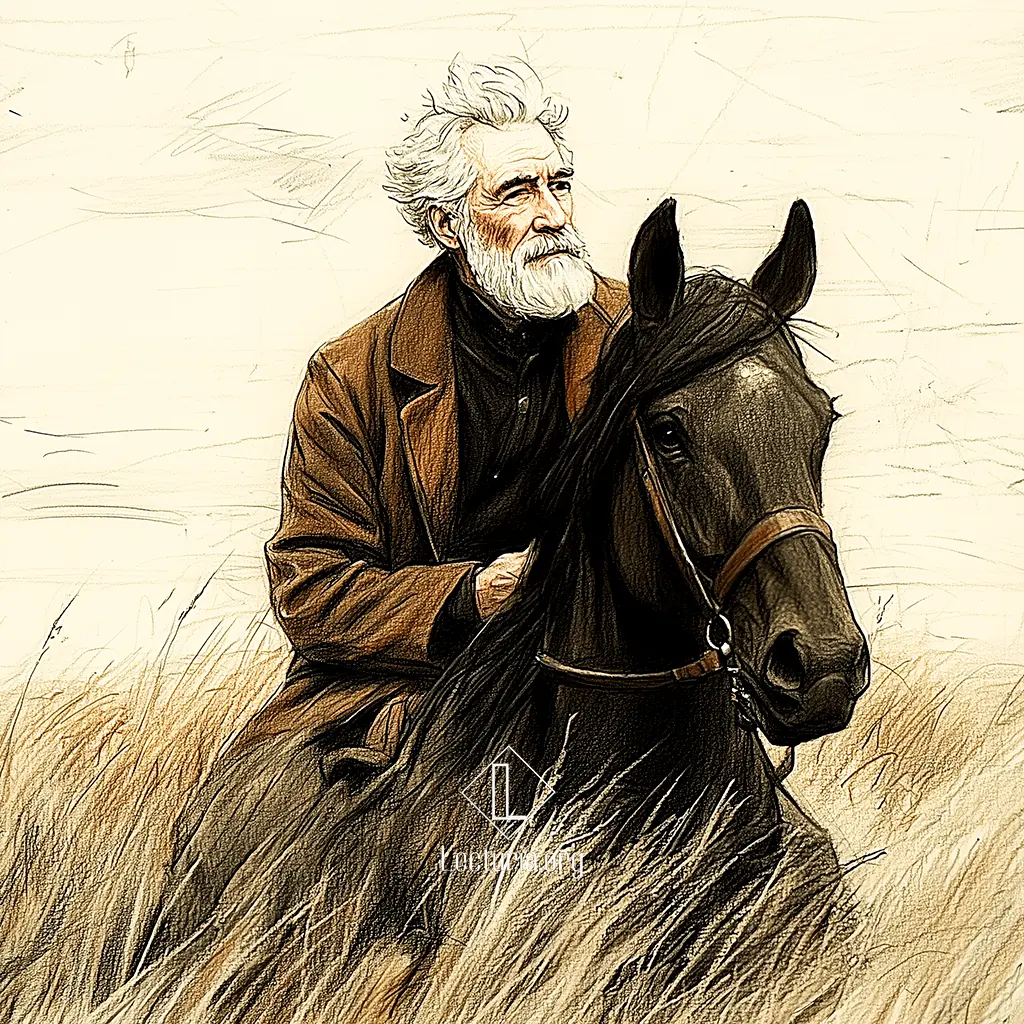
Avertissement
Le résumé et l’analyse qui suivent ne sont qu’une apparence et l’une des nombreuses lectures possibles du texte. Ils ne se substituent en aucun cas à l’expérience de la lecture intégrale de l’œuvre.
Résumé de Le gaucho insupportable, de Roberto Bolaño
« Le gaucho insupportable », nouvelle qui donne son titre au recueil publié par Roberto Bolaño en 2003, raconte l’histoire de Manuel Pereda, avocat veuf et père de deux enfants — la Cuca et le Bebe — menant une existence tranquille, méticuleuse et solitaire à Buenos Aires. Homme honnête et attaché à la routine, Pereda a refusé de se remarier après la mort de sa femme, décidé à élever seul ses enfants. Avec le temps, ceux-ci grandissent et quittent le pays : la fille s’installe à Rio de Janeiro, et le fils, devenu un écrivain reconnu, vit à l’étranger. Seul et vieillissant, Pereda assiste à la dégradation économique et sociale de l’Argentine au début du XXIᵉ siècle, et subit l’effondrement du système financier, perdant toutes ses économies.
Secoué par cette crise et voyant Buenos Aires s’écrouler, il décide de quitter la ville pour s’installer à la campagne, dans l’ancienne estancia familiale, appelée Álamo Negro, située dans la pampa. Il fait ses adieux à ses domestiques, qu’il ne peut plus payer, et prend le train pour Capitán Jourdan, un village rural presque désert, envahi par les lapins. Là, il découvre la maison en ruine et un paysage hostile. Il achète quelques ustensiles à la quincaillerie, obtient un cheval nommé José Bianco dans l’estancia voisine de don Dulce et s’installe précairement dans sa nouvelle vie. Dès lors, il s’efforce de reconstruire la propriété, entouré de personnages désorientés : vieux gauchos, enfants faméliques et voisins marginaux.
Pereda, sans expérience de la vie rurale, improvise des pièges pour chasser les lapins, embauche des gauchos inefficaces et organise lentement une minuscule communauté. Il raconte des histoires, souvent inventées, et réfléchit à voix haute sur la justice, la patrie et la littérature. Il reçoit la visite de son fils écrivain et de plusieurs habitants de Buenos Aires, parmi lesquels un éditeur — mordu par un lapin — et une psychiatre grandiloquente qui l’accompagne dans une traversée à cheval. Au cours de cette expédition, ils rencontrent une femme mystérieuse vivant avec ses enfants dans une estancia abandonnée. Quelque temps plus tard, elle vient s’installer à Álamo Negro, s’y installe sans grands discours, et une nuit partage le lit de Pereda, établissant avec lui une forme de cohabitation silencieuse.
La vie à Álamo Negro, bien que précaire, se stabilise : la nourriture s’améliore, d’autres gauchos s’y joignent, et même une ONG médicale arrive pour vacciner les habitants. L’estancia devient un refuge de l’essentiel. Pereda, toujours désabusé du pays, semble trouver un sens à cet isolement. Il discute politique avec les gauchos et, lorsque certains expriment leur nostalgie du péronisme, il réagit avec une violence verbale et même un couteau dégainé, sans toutefois s’en servir. Malgré ces tensions, la propriété continue de fonctionner comme une petite communauté à la dérive.
Lorsque son fils lui demande de revenir en ville pour signer la vente de l’appartement familial, Pereda retourne à Buenos Aires. Il trouve l’appartement propre mais vide. Il appelle ses anciennes employées, erre dans les rues, se sent perdu. Une nuit, il aperçoit depuis la fenêtre d’un café son fils entouré d’écrivains. L’un d’eux, auteur narcissique et drogué, sort pour l’invectiver. Pereda le blesse légèrement à l’aine avec un couteau et disparaît dans l’ombre. Il parcourt la ville sans savoir s’il doit rester ou repartir. Il s’imagine entrant à cheval dans Buenos Aires, comme une figure messianique ou ridicule. À l’aube, il décide finalement de retourner à la pampa.
Commentaire et analyse de Le gaucho insupportable, de Roberto Bolaño
« Le gaucho insupportable », la nouvelle qui donne son nom au recueil homonyme de Roberto Bolaño, est un récit ample, empreint d’ironie, d’ambiguïté et de références littéraires, qui met en scène la transformation d’un citadin en une figure rurale frôlant le grotesque. Cependant, au-delà de la dimension comique que peuvent suggérer certaines scènes — comme celle où le protagoniste entre à cheval dans une pulpería —, le texte explore avec profondeur le désarroi existentiel d’un homme qui, dans une Argentine en crise, cherche un nouveau sens à sa vie au milieu de l’effondrement politique, économique et culturel du pays.
Le protagoniste, Manuel Pereda, est un avocat retraité, veuf et père de deux enfants brillants, qui a mené une vie ordonnée et bourgeoise à Buenos Aires. Son monde s’écroule lorsque ses enfants quittent le foyer et que l’Argentine s’enfonce dans une crise profonde. Face à cette situation, Pereda se retire dans l’estancia familiale, Álamo Negro, située dans la pampa, dans l’intention de reconstruire sa vie à partir de l’essentiel. Ce retour à la campagne est à la fois littéral et symbolique : il marque un retrait du monde moderne, mais aussi une quête d’identité. En substance, le récit pose une question centrale : que signifie « être Argentin » ? Est-il possible de reconstruire une identité nationale à partir des débris d’une civilisation urbaine en ruines ?
La nouvelle fonctionne comme une double traversée : celle de la transformation personnelle de Pereda et celle d’un déplacement symbolique à travers les mythes de l’histoire et de la littérature argentines. Le protagoniste, bourgeois cultivé et rationnel, lecteur de journaux et habitué des cafés littéraires, est poussé par l’effondrement national dans un processus de ruralisation forcée, à la fois grotesque et pathétique. Dans la pampa, Pereda imite la figure du gaucho : il monte à cheval, porte la bombacha, chasse les lapins et fréquente la pulpería. Mais cette identité demeure fragile et théâtrale. Il ne devient pas un gaucho ; il en joue le rôle, se transformant en une figure ambiguë — mi-tragique, mi-ridicule — incarnant le désir d’appartenance à un pays en voie de désintégration et à une tradition disparue.
Un aspect significatif du récit est sa relation avec la nouvelle Le Sud de Jorge Luis Borges, à laquelle il fait explicitement allusion lorsque Pereda attend à la gare. Chez Borges, Juan Dahlmann part à la campagne dans l’espoir d’échapper à la modernité et de retrouver une forme héroïque du passé, pour mourir dans un duel final dans une pulpería. Bolaño reprend ce même trajet vers le sud comme espace symbolique, mais le subvertit complètement. Le gaucho de Borges est digne, tragique et silencieux ; celui de Bolaño est « insupportable », artificiel, déplacé et trop conscient de jouer un rôle qui n’a plus de sens. La figure héroïque est remplacée par la comédie, la maladresse et l’anachronisme. Il n’y a pas de duel, mais des crachats. Pas de mort noble, mais une survie précaire.
Bolaño ne se moque ni du gaucho ni de Borges ; il les transpose dans un autre contexte, comme pour se demander : quel sens cela a-t-il aujourd’hui, en pleine faillite, avec des lapins à la place des vaches, de parler de gauchos ? Que reste-t-il du passé national dans un présent détraqué ? La scène où Pereda entre à cheval dans la pulpería, commande de l’eau-de-vie et crache par terre semble une parodie de Le Sud, mais aussi un hommage. Car, au fond, Pereda cherche désespérément une forme de vie authentique, même si le monde ne lui offre plus aucun cadre pour la soutenir.
Sur le plan narratif, la nouvelle combine un ton objectif, presque neutre, avec des moments de délire, d’ironie et de lyrisme. Elle est écrite à la troisième personne, mais le narrateur se rapproche progressivement de la conscience de Pereda, jusqu’à se confondre avec sa pensée. Cette proximité permet à Bolaño de jouer sur l’ambiguïté : on ne sait jamais clairement si Pereda est un homme lucide ayant choisi une vie marginale et poétique, ou s’il sombre peu à peu dans la folie en cherchant à donner sens à une réalité détraquée. Cette ambiguïté parcourt tout le récit, maintenant une tension constante entre comédie et tragédie.
L’espace rural de la nouvelle adopte une esthétique presque dystopique. La pampa n’est plus le territoire épique de la tradition gauchesque, mais un paysage dégradé, envahi par les lapins — symbole d’une prolifération incontrôlée, de la perte d’équilibre écologique et, peut-être, de l’impossibilité de revenir à un ordre antérieur. Il n’y a ni vaches, ni maître, ni histoire. Dans ce vide, Pereda tente de reconstruire une communauté précaire : il rassemble des gauchos déclassés, accueille une femme énigmatique et ses enfants, reçoit la visite d’éditeurs, de médecins, d’écrivains. Pourtant, tout semble au bord de l’effondrement ou de l’absurde. L’estancia Álamo Negro devient une île au milieu du désert, plus proche d’une ruine habitée que d’une propriété productive.
La tension entre ville et campagne est également significative. Buenos Aires apparaît comme un espace artificiel et vide, où les intellectuels discutent dans les cafés de politique et de littérature sans effet réel. La campagne, bien que délabrée, semble offrir un contact plus direct avec le concret : la faim, le besoin, le travail. Mais Bolaño n’idéalise ni l’un ni l’autre. Dans les deux, il y a du simulacre, de la décadence et du désenchantement. Ce qui l’intéresse, au fond, c’est de montrer un personnage déplacé entre deux mondes qui n’offrent plus de certitudes, mais qui persiste à résister.
Le gaucho insupportable est un récit sur le décalage entre les formes héritées de penser une nation et l’expérience chaotique de la vivre au présent. Manuel Pereda est un personnage anachronique, survivant d’une classe instruite qui a perdu sa place, tentant de se réinventer dans un pays en ruines. Sa figure est contradictoire : parfois pathétique, parfois touchante, parfois ridicule. Mais c’est dans cette contradiction que réside son humanité. La nouvelle n’offre ni réponse ni morale. Elle propose plutôt un regard lucide — et amer — sur ce qu’il reste quand tout s’est défait : une vie construite à partir de débris, de fictions tenues pour vraies, d’efforts vains pour donner forme à un monde qui n’en a plus.